Thématique
Nouvelle étude de la CFM : La naturalisation, un privilège

Depuis l’introduction de la nouvelle loi sur la nationalité en 2018, la naturalisation ordinaire est devenue plus sélective : la part des personnes hautement qualifiées et aisées a augmenté de manière significative, et le nombre de personnes peu qualifiées et aux revenus plus faibles a nettement diminué. C’est ce que montre l’étude « La naturalisation ordinaire en Suisse », rédigée sur mandat de la Commission fédérale des migrations CFM. Les analyses statistiques effectuées démontrent une sélectivité nette qui découle d’une part des dispositions légales bien plus restrictives. D’autre part, cette sélectivité s’inscrit comme une conséquence des marges de manœuvre accordées aux cantons par la loi fédérale sur la nationalité. Se basant sur ces constats, l’étude propose des pistes pour rendre la naturalisation plus inclusive.
L’enquête, menée par des chercheurs des Universités de Genève, Neuchâtel et Bâle, montre les effets de la nouvelle loi sur la nationalité LN sur la naturalisation ordinaire en Suisse. Elle couvre les trois années qui ont suivi l’introduction du nouveau droit en 2018, période durant laquelle les naturalisations se sont effectuées à la fois selon l’ancien et le nouveau droit, en fonction de la date de soumission de la demande. Sur cette période, environ un tiers des personnes naturalisées selon l’ancien droit disposaient d’un diplôme universitaire, contre près de deux tiers selon le nouveau droit. En revanche, la part des personnes n’ayant pas poursuivi leur formation au-delà de l’école obligatoire est passée de 23.8 à 8.5 pour cent.
Nouvelles restrictions dans la loi fédérale
L’étude avance les explications suivantes pour décrire cette nouvelle sélectivité :
En 2018, de nouveaux critères plus restrictifs ont été introduits. Désormais, seules les personnes vivant en Suisse depuis au moins dix ans et en possession d’un permis d’établissement sont admises à la procédure de naturalisation. Il convient de souligner que le statut en matière de droit des étrangers influence considérablement le délai dans lequel ceux-ci peuvent bénéficier d’un permis d’établissement.
Par ailleurs, pour être naturalisés, les candidats doivent remplir de nouveaux critères d’intégration. Les connaissances linguistiques et l’indépendance économique constituent des obstacles particuliers. Pour les personnes peu qualifiées et moins aisées, surmonter ces écueils est un défi, car il leur est plus difficile d’acquérir les connaissances linguistiques écrites et orales nécessaires. En outre, pour elles, le risque de devoir recourir à l’aide sociale est plus élevé.
Les marges de manœuvre de la loi fédérale engendrent une pratique inégale
La sélectivité mise en évidence par les statistiques varie considérablement selon les cantons. L’étude attribue ces différences aux marges de manœuvre réglementaires et juridiques que la Confédération accorde aux cantons, et que ceux-ci utilisent différemment.
Marges de manœuvre cantonales au niveau réglementaire : cinq cantons ont d’ores et déjà fixé des niveaux de langue plus élevés que ceux exigés par la loi fédérale. Et environ un tiers des cantons a augmenté les exigences concernant le remboursement des prestations d’aide sociale. Cela impacte les personnes peu qualifiées aux revenus plus faibles.
Marges de manœuvre cantonales pour la mise en œuvre des directives juridiques : Conformément au droit cantonal, ce sont les responsables de la naturalisation qui évaluent dans les communes de résidence des candidats si ceux-ci sont intégrés et familiarisés avec les conditions de vie en Suisse. En cela, les communes jouissent d’une autonomie vaste. Cela peut conduire également à privilégier les personnes hautement qualifiées et aisées.
Propositions pour une loi sur la nationalité plus inclusive
Partant du constat que la sélectivité est nettement plus marquée depuis l’introduction de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité, l’étude présente des pistes pour un système de naturalisation plus inclusif en proposant des mesures concrètes.
En outre, l‘étude propose des approches pour une réorientation fondamentale du droit de la nationalité, à savoir de passer d’une procédure de naturalisation à trois niveaux à un système de naturalisation à un seul niveau, une procédure simple, uniforme et transparente pour tous, et un droit à la naturalisation pour les personnes nées et ayant grandi en Suisse.
La CFM demande un large débat sur la naturalisation
Au vu des résultats de l’étude, la CFM demande à présent un large débat sur la naturalisation et ses régulations, à tous les niveaux de l’État fédéral, dans les institutions et organisations politiques, ainsi qu’avec la société civile. « Les personnes peu qualifiées ou issues du domaine de l’asile se voient de plus en plus exclues de la procédure de naturalisation. Cela parce qu’elles ne sont pas admises à la procédure en raison de critères plus stricts et parce que les obstacles ont été nettement relevés », constate Manuele Bertoli, président de la Commission fédérale des migrations CFM. De l’avis de la CFM, il s’agit d’une dérive. L’accès à la naturalisation devrait être conçu de telle sorte qu’elle serve à l’intégration de la société dans son ensemble.
E-Diaspora
-
 Emilia assure votre bien-être juridique Emilia, l’assurance de protection juridique, permet tout d’abord d’éviter les litiges juridiques ; si cela n’est...
Emilia assure votre bien-être juridique Emilia, l’assurance de protection juridique, permet tout d’abord d’éviter les litiges juridiques ; si cela n’est... -
 Arbenita Sopaj, un modèle de réussite dans la “diplomatie japonaise”
Arbenita Sopaj, un modèle de réussite dans la “diplomatie japonaise” -
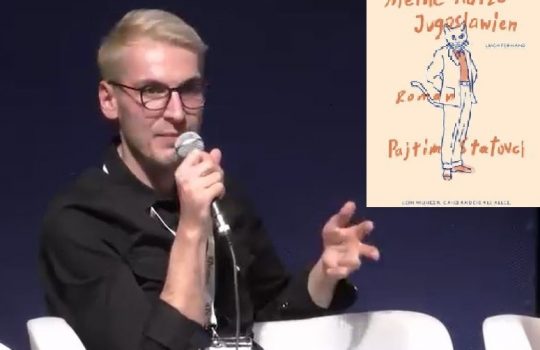 Pajtim Statovci remporte le Prix international de littérature pour son roman “Mon chat, la Yougoslavie”
Pajtim Statovci remporte le Prix international de littérature pour son roman “Mon chat, la Yougoslavie” -
 Le KF Prishtina de Berne remporte la Coupe de l’Union des clubs albanais en Suisse
Le KF Prishtina de Berne remporte la Coupe de l’Union des clubs albanais en Suisse -
 Le tribunal fédéral décide : l’homme qui a tué sa femme ne sera pas expulsé vers le Kosovo
Le tribunal fédéral décide : l’homme qui a tué sa femme ne sera pas expulsé vers le Kosovo
Vivre en Suisse
-
 Emilia assure votre bien-être juridique Emilia, l’assurance de protection juridique, permet tout d’abord d’éviter les litiges juridiques ; si cela n’est...
Emilia assure votre bien-être juridique Emilia, l’assurance de protection juridique, permet tout d’abord d’éviter les litiges juridiques ; si cela n’est... -
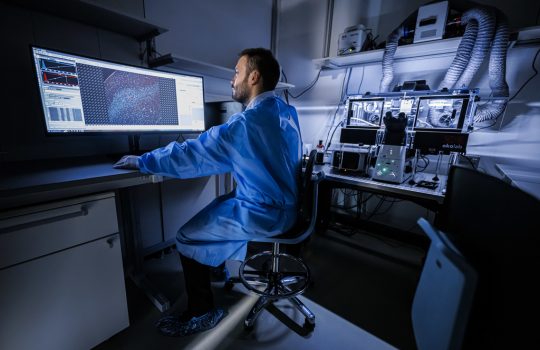 Les chercheurs suisses admis à une participation élargie à Horizon Europe
Les chercheurs suisses admis à une participation élargie à Horizon Europe -
 Le KF Prishtina de Berne remporte la Coupe de l’Union des clubs albanais en Suisse
Le KF Prishtina de Berne remporte la Coupe de l’Union des clubs albanais en Suisse -
 Le tribunal fédéral décide : l’homme qui a tué sa femme ne sera pas expulsé vers le Kosovo
Le tribunal fédéral décide : l’homme qui a tué sa femme ne sera pas expulsé vers le Kosovo -
 Soutien aux régions victimes des intempéries
Soutien aux régions victimes des intempéries






















